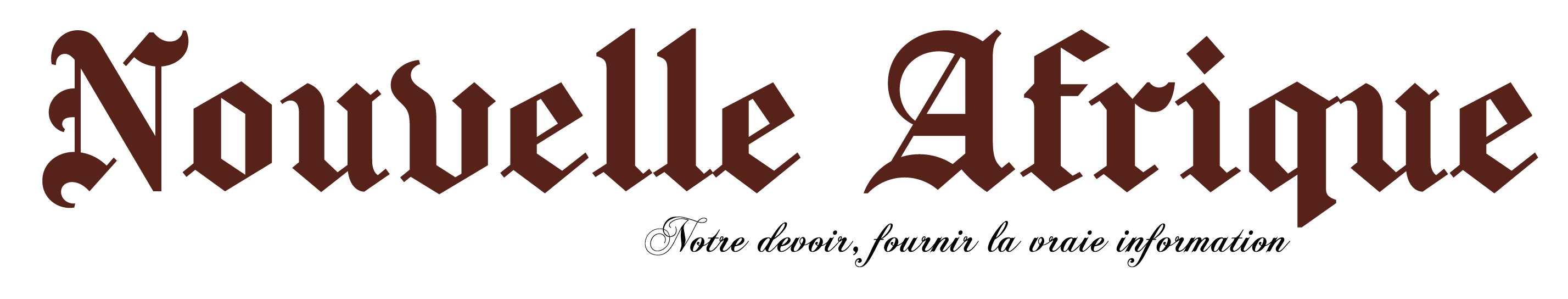Harouna Diallo, maître de conférences des universités et Professeur de la géopolitique, livre dans cet entretien exclusif ses analyses sur la situation au Niamey. Selon lui, l’avenir du combat contre le jihadisme au Sahel se joue au Niger.
Nouvelle Afrique : Le Niger fait face depuis début juillet à un putsch. Comment analysez-vous cet énième coup d’État dans l’espace francophone ? Qu’est-ce qu’il peut changer dans la géopolitique au Sahel ?
Harouna Diallo : Le putsch qui a eu lieu au Niger le 26 juillet 2023 n’est pas un putsch de plus mais le putsch de trop, qui donne lieu à un bras de fer entre la CEDEAO et les militaires au pouvoir. Les enjeux du quatrième putsch en Afrique de l’Ouest en deux ans (après le Mali , la Guinée et le Burkina Faso ) sont, en effet, majeurs pour le Niger, pour la région et au-delà.
Selon les putschistes, c’est la dégradation de la situation sécuritaire qui les aurait incités à prendre le pouvoir . Or, à l’inverse du Mali et du Burkina Faso, le Niger n’est pas en partie occupé par les groupes jihadistes. Certes menacé par Boko Haram au sud dans la région de Diffa et par les groupes armés affiliés à Al-Qaida et à l’État islamique à l’ouest dans les régions de Tillabéri et Tahoua, le pays n’a pas connu d’attaques majeures cette année.
De même, à l’inverse du Mali et du Burkina Faso, les militaires auteurs du coup d’Etat au Niger n’incarnent pas une nouvelle génération montante et insatisfaite au sein de l’armée. Âgé de 59 ans, le principal auteur du coup d’État, le général Abdourahamane Tiani , était le chef de la garde présidentielle depuis 2011, tandis que le numéro 2 de la junte, le général Mody, à 60 ans, était le chef d’ état-major des armées de 2020 à avril 2023 .
N.A : Que pensez-vous que la décision de la CEDEAO de déployer des troupes au Niger pour rétablir Mohamed Bazoum ?
H.D : L’Afrique de l’Ouest connaît une véritable épidémie de putschs. Le Niger est le quatrième pays touché en trois ans : le Mali a ouvert le bal en 2020 suivi par la Guinée en 2021 et le Burkina Faso par deux fois en 2022. Quatre présidents élus (Ibrahim Boubacar Keïta, Alpha Condé, Roch Kaboré et Mohamed Bazoum) ont été destitués par des hommes en uniforme.
En tant qu’organisation chargée de la paix et de la sécurité dans la région, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) joue son va-tout. Impuissante face aux trois coups d’État précédents, surprise par ce quatrième putsch, la CEDEAO se trouve maintenant face à une menace existentielle pour les régimes politiques de la région qui se disent démocratiques.
L’organisation régionale a donc avec force rejeté ce quatrième putsch :
- Ultimatum d’une semaine aux putschistes pour rendre le pouvoir au président Bazoum.
- Train complet de sanctions économiques et financières (fermeture des frontières terrestres et aériennes, gel des avoirs de la République du Niger dans les banques centrales de la CEDEAO, suspension des transactions commerciales et financières entre les États membres de la CEDEAO et le Niger, gel de toutes les transactions de service, etc.).
- Et surtout, menace inédite d’une intervention militaire.
Mais loin de reculer, la junte nigérienne a surenchéri en nommant un premier ministre, en accusant le président arrêté de haute trahison et en se rapprochant des trois autres régimes militaires. Ce rapprochement a conduit à une déclaration de solidarité belliqueuse des juntes malienne et burkinabé qui considère qu’une intervention militaire de la CEDEAO au Niger serait « une déclaration de guerre » .
L’organisation régionale est donc à présent scindée en deux blocs antagonistes – les régimes civils et les juntes – qui sont entrés dans une logique d’escalade. La rhétorique belliciste de ces dernières semaines évoquant une guerre régionale fait partie de la partie de bras de fer qui se déroule entre la militaires et la CEDEAO et dont l’enjeu définira les perdants et les gagnants de cette crise.
N.A : Quels sont les risques d’une intervention militaire au Niger, particulièrement pour le Mali?
H.D : Les nouveaux hommes forts nigériens jouent bien sûr leur avenir personnel, tout comme les présidents élus de la CEDEAO. Ces derniers savent que ce n’est plus leur crédibilité qui est en cause, mais leur avenir. Après avoir échoué face à trois coups d’État, leur impuissance pourrait donner des idées à certaines de leurs propres militaires, qui suivent de près l’irrésistible ascension des militaires. Quant aux putschistes déjà au pouvoir dans les pays voisins, la confirmation de l’installation au Niger d’une nouvelle junte serait les conforter et serait célébrée comme une nouvelle étape du retour des militaires au pouvoir en Afrique de l’Ouest.
N.A : Quels sont, selon vous, les différents scénarios pour la suite ?
H.D : Après son expulsion du Mali et du Burkina Faso, l’armée française risque d’être complètement expulsée du champ de bataille sahélien, les putschistes ayant exigé son départ d’ici septembre. Même si les putschistes s’en prennent en priorité à la France, ce risque d’expulsion peut porter également sur les troupes européennes et américaines stationnées au Niger. En ce sens, l’avenir de la guerre contre le djihadisme sahélien se joue au Niger.
En outre, le rapprochement immédiat avec les pouvoirs militaires voisins et leurs amis russes augure d’une réorganisation régionale des alliances. Grâce à un jeu de dominos parfait, un Sahel hostile aux intérêts occidentaux et prêt à explorer tous les partenariats alternatifs sur le marché de l’aide (pas seulement russe mais aussi arabe, chinois, etc.) est en train d’être créé. À ce titre, les similitudes du schéma des coups d’État entre Bamako, Ouagadougou et Niamey ne peuvent qu’interroger : même justification sécuritaire, même posture anti-française et même appel à la Russie. Le Sahel devient un nouvel exemple de la perte d’influence des États-Unis et de l’Europe sur la scène internationale et du déclassement de la France, qui fait figure de grand perdant. En ce sens, la guerre d’influence entre grandes puissances se joue aussi au Niger et au Sahel.