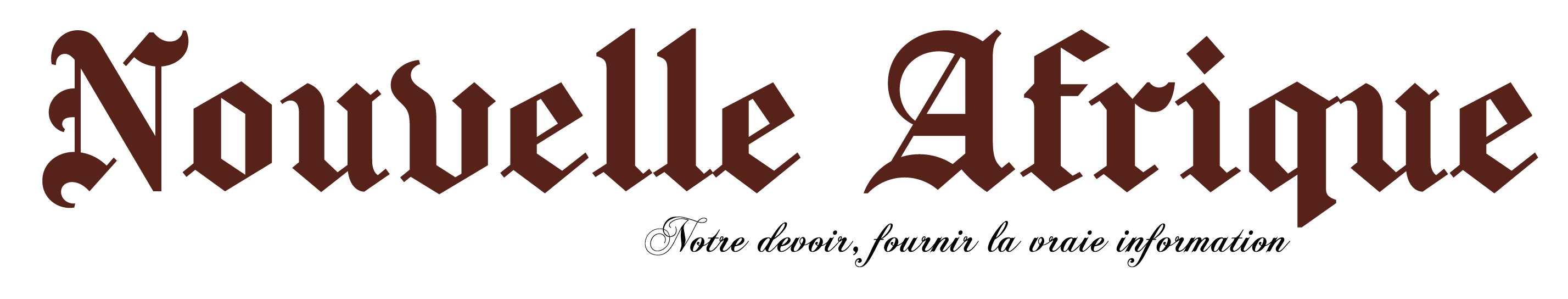C’est mon avis, c’est mon approche. J’y suis pour et je n’y vois aucun problème. Ma démarche est comparative et facile à comprendre. Mon cheminement est simple, tout aussi simple que les raisons pour lesquelles je m’inscris pleinement dans cette perspective.
Premièrement, il est essentiel de garder à l’esprit que la majorité des groupes, qu’ils soient de nature terroriste ou rebelle, sont constitués de Maliens. Il est donc nécessaire, à ce titre, de dialoguer avec eux, tant que les principes fondamentaux de la Constitution ne seront pas mis en cause (le caractère républicain, la laïcité, l’indivisibilité de l’Etat, etc.).
Deuxièmement, diriger, rappelez-vous-en, signifie savoir se vêtir de deux peaux : celle du lion et celle de renard. Comme avait exactement compris le secrétaire florentin Nikola Machiavel.
Se vêtir de la peau du lion pour contenir les insurgés dans les limites de la légalité, de la loi ; pour effrayer et faire sentir à tous la puissance du feu de ce grand monstre (État) qui n’est perceptible que par les effets et les conséquences de son action. Et les forces armées du Mali s’y sont parvenues avec succès. Car, pour la première fois depuis notre indépendance, les groupes armés ne se sont jamais sentis aussi affaiblis qu’à présent.
La peau du renard pour tendre la main à tous, pour éviter les pièges résultant d’une utilisation excessive de la force, apaiser les obstacles découlant de l’usage de cette même force. Il faut aussi garder à l’esprit que, là où les militaires passent, les diplomates doivent s’y établir pour assoupir les tensions, réconcilier les positions. Il serait avisé que les sociologues s’y résident pour examiner et expliquer les origines de la crise. Tandis que les hommes de droit doivent s’y installer pour rendre justice aux victimes en établissant la vérité des faits. Et l’économiste pour y élaborer ou dégager les perspectives susceptibles de mener à l’emploi, etc.
Toutefois, il me semble que, dans le contexte malien, là où les militaires passent, on préfère y construire ou y privilégier l’édification d’une base militaire plutôt que de pencher et d’éplucher les causes fondamentales pour lesquelles sont intervenus les militaires. Bref, il faut baisser les armes et tendre la main quand on est en position de force.
Troisièmement, les cas afghan et colombien peuvent nous servir des références. Je sais que comparaison n’est pas raison. Mais la comparaison permet souvent d’entendre l’horizon de la raison et surtout de la compréhension.
La Colombie faisait face aux FARC (Forces armées révolutionnaires de Colombie), considérées comme l’organisation terroriste la plus dangereuse et la plus redoutable à l’échelle mondiale. Malgré des dizaines de milliers de mort en plus de 50 ans de conflit contre ce groupe, les autorités colombiennes n’ont jamais réussi à le vaincre. Pour mettre un terme au conflit et assurer la stabilité du pays, le gouvernement colombien a dû engager des pourparlers avec les FARC, ce qui a conduit à la transformation de ce groupe armé en une formation politique.
Un autre exemple similaire. Les Américains, avec une coalition de plus de 140 000 soldats, ont dépensé plus de 1000 milliards de dollars en Afghanistan, selon le géopolitologue français Pascale Boniface. Soit plus de 150 ans de budget annuel du Mali. Mais jamais ils sont parvenus à étouffer les Talibans après plus de 20 ans de guerre. Ils ont fini par se retrouver autour de la table de négociation.
Encore plus près de chez nous, l’Algérie – peu de gens (de ma génération) le savent – a été confrontée dans les années 90 à un terrorisme qui fut – dans certaines de ses composantes – plus meurtrier et plus dévastateur que celui que nous vivons aujourd’hui. Le Front islamique du salut, le Groupe islamique armé et tant d’autres groupes à caractère terroriste avaient souillé le sol algérien par le sang, participé à isoler le pays, etc. Mais seule par la vertu de la ruse, du dialogue, l’Algérie a pu tourner cette page sombre de son histoire.
Conclusion : jamais par la seule voie militaire, on peut venir à bout de la force de la croyance, de la conviction de mourir pour une vie transcendante. C’est la loi de la physique : le mouvement ne produit que du mouvement. La solution exclusivement militaire ne me paraît pas toujours être la meilleure. Il est donc impératif d’avoir le courage de discuter et de dialoguer avec intelligence.
L’option militaire est indispensable, mais il est essentiel d’y intégrer d’autres approches. Nous savons tous que l’armée est en position de force, nous avons acheté suffisamment de matériels militaires, conquis une grande partie du territoire. Il faut à présent gagner les cœurs et les esprits en créant des emplois, en offrant d’autres perspectives susceptibles d’influencer et de traiter le cœur du problème.
Enfin, j’espère que mes propositions pour une sortie de ce cercle perpétuel d’effusion de sang ne seront pas interprétées autrement, ou comprises sous l’angle d’incapacité de nos forces armées à vaincre le terrorisme. Je ne mets pas en cause la capacité de l’armée. C’est tout le contraire. Je n’offense ni l’armée, ni sa hiérarchie. Je ne remets donc en cause ni l’intégrité ni les compétences de quiconque. En tant que citoyen engagé pour sa patrie depuis toujours et qui participe à l’effort de guerre à travers la taxation imposée, je propose tout simplement une autre alternative de sortie de crise. Comme il devrait en être le cas pour tout citoyen. Et si, en dépit de toutes ces clarifications, il arrive que les grands magistrats de la République parviennent à extraire quelques motifs juridiques dans les lignes précédentes, qu’ils comprennent, pour s’excuser, que ce sont tout simplement des propositions d’un simple citoyen loin des affaires (militaires) et qui cherche à s’y perfectionner.
Sekhou Sidi Diawara dit « serpent », chercheur à l’université de Belgrade
Adresse email : diawara.sekhousidi@yahoo.fr