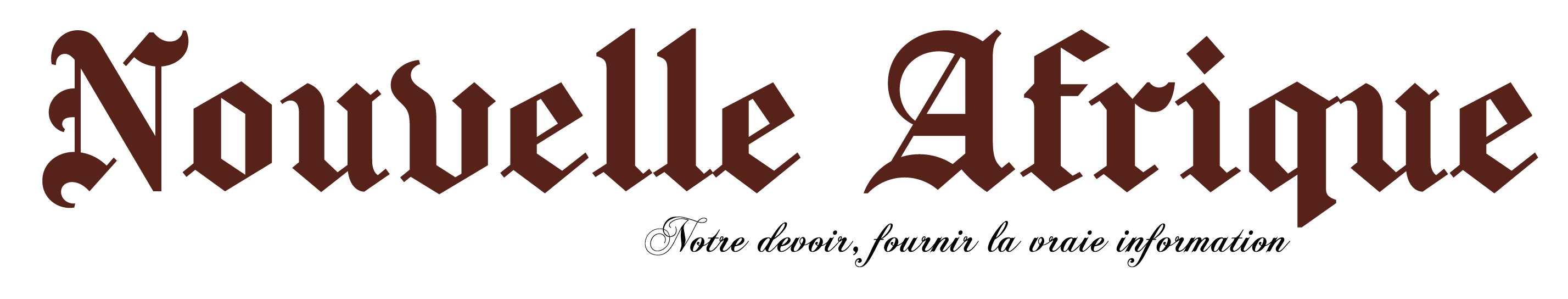Après l’annonce par l’Union européenne (UE) du rappel de son ambassadeur du Niger, les autorités nigériennes ont indiqué, dimanche, que ce sont elles qui ont demandé le départ de Salvador Pinto Da França de leur territoire en raison d’une collaboration devenue «impossible». Cette crise est née de la gestion des fonds alloués aux victimes des inondations.
Le torchon brule entre les autorités de la transition au Niger et la mission de l’Union européenne. Pour cause : la gestion de l’aide humanitaire de l’UE en faveur des victimes de l’inondation.
Une gestion «opaque» de l’aide
En effet, dans un premier communiqué, Niamey a dénoncé « l’opacité » dans la gestion de l’aide humanitaire de l’Union européenne à l’endroit des victimes des inondations. Selon le gouvernement nigérien, même s’il n’est pas demandeur de cette aide, elle doit etre gérée de façon concertée entre ses services et la mission de l’UE. Le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur a ainsi fustigé «l’ingérence de l’UE dans la gestion internes en utilisant des ONG». Une accusation réfutée, le 23 novembre, par l’Union européenne qui a indiqué que l’aide en question était gérée en toute impartialité.
Une crise diplomatique
L’affaire tourne en crise diplomatique entre le Niger et l’Union européenne. En effet, dans son communiqué de désapprobation de la sortie du gouvernement nigérien, l’Union européenne a annoncé le rappel de son ambassadeur au Niger pour «consultations» à Bruxelles, en Belgique. Elle décrit cette décision comme une réponse à la détérioration des relations diplomatiques avec le Niger.
Pour sa part, le Niger rejette, lui aussi, cette version sur le départ de l’ambassadeur Salvador Pinto Da França. Selon son ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur, c’est plutôt le gouvernement qui a demandé le rappel et le remplacement du diplomate «dans un bref délai». Niamey reproche à l’ambassadeur Salvador Pinto Da França un «manque de respect» à l’endroit des autorités de la transition.
B.G/NouvelleAfrique