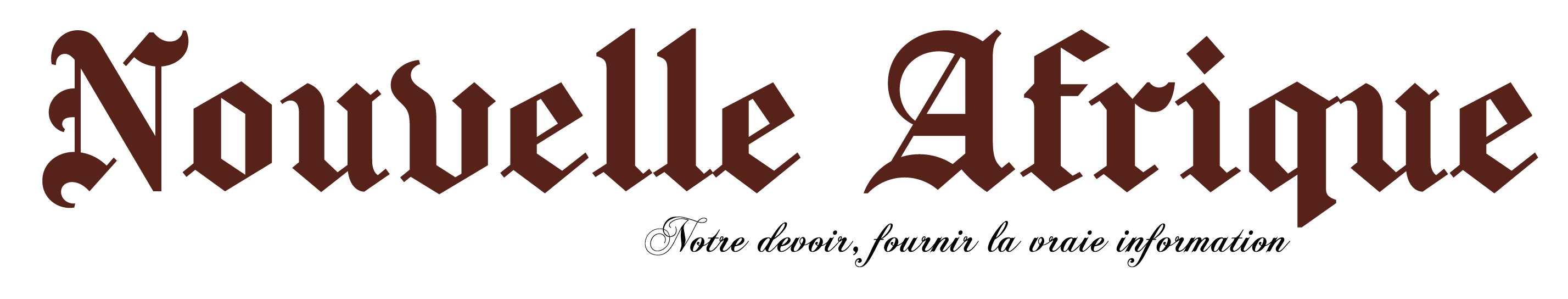L’état économique du Mali, la situation de l’inflation, l’impact de l’embargo de la CEDEAO, la crise énergétique, le budget des institutions, l’Alliance des Etats du Sahel (AES) et son projet de Union économique, l’avenir du CFA… tels sont entre autres des points sur lesquels l’économiste réputé Modibo Mao Makalou a livré son avis et ses analyses dans cet entretien exclusif.
Nouvelle Afrique : Qui est Modibo Mao Makalou, ce nom qui comporte ceux de deux anciens présidents malien et chinois?
Modibo Mao Makalou : Modibo Mao Makalou est un Malien qui a eu le privilège d’être né en Chine à l’hôpital américain de Pékin, de faire ses classes primaires au Mali, ses classes secondaires aux États-Unis, son Baccalauréat en France, ses études universitaires au Canada et aux États-Unis et qui est rentré au Mali en 1992 après avoir obtenu son diplôme de MBA en Finance Internationale. Au Canada, j’ai fait une maîtrise en sciences économiques en 1987.
Beaucoup de gens m’appellent Docteur, je ne le suis pas car je n’ai jamais ambitionné d’enseigner dans les cycles supérieurs ou de conduire des projets et programmes de recherche. Je suis MBA en Finance internationale et gestionnaire financier. C’est mon père Oumar Barou Makalou (Paix à son âme) qui nous a quittés 7 ans jour pour jour aujourd’hui qui était Docteur d’Etat en sciences économiques de l’Université de Paris-Sorbonne. Les gens font souvent la confusion.
N.A : D’où est venu la combinaison Modibo Mao ?
M.M.M : Modibo Keïta était le premier président du Mali dont mon père était le collaborateur. Il fut le maître de mon père au primaire et c’est aussi lui qui a célébré le mariage de mes parents puis a coïncidé avec ma naissance à Pékin lors d’une visite officielle. Mon père était politiquement de gauche à l’époque et admirait le président (chinois) Mao (Zhedong). Donc il a décidé de combiner le nom de ces deux grands hommes. Je suis leurs homonymes.
N.A : Trois ans après le début de la Transition, comment voyez vous l’état économique du Mali ?
M.M.M : L’économie malienne est résiliente malgré que le monde soit en ébullition depuis quelques années. Malheureusement les défis et les menaces aujourd’hui sont globaux et mondiaux. Nous avons commencé à la fin de l’année 2019 et au début de 2020 avec la pandémie sanitaire de la Covid-19. Vous avez vu l’impact négatif que cela a eu sur l’économie mondiale notamment le commerce mondial et l’activité économique de notre pays qu’on appelle le Produit Intérieur Brut (PIB) dépend à 60% du commerce international. C’est-à-dire des importations (biens et services que nous achetons à l’extérieur) et des exportations (biens et services que nous vendons à l’extérieur). Donc vous pouvez comprendre que cela a eu des impacts assez négatifs sur notre économie.
Ensuite, il y a eu aussi les sanctions de la CEDEAO. La fermeture des frontières, le gel des avoirs de l’Etat malien surtout du compte unique du trésor au niveau de la banque centrale, de même que le gel des financements des banques de développement et de certaines entreprises publiques ont contribué à ralentir l’économie sans compter le fait que nous n’avions plus accès au marché sous-régional des capitaux pour le financement des dépenses publiques.
Les huit pays qui partagent le CFA ont en commun un marché de capitaux sur lequel les Etats financent leurs trésoreries. Nous avions été exclu temporairement de ce marché. Tout cela a impacté négativement notre pays. À cela s’est greffé la guerre en Ukraine qui a contribué a augmenté l’inflation qui est devenue mondiale parce que les prix du baril de pétrole ont augmenté, tirant ainsi vers la hausse le prix des biens et services.
Déjà le commerce maritime dépend à 80% du prix pétrole. Au Mali, nous n’en produisons pas et les hydrocarbures et leurs dérivés sont notre premier poste d’importation. Près de 30% de tout ce que nous achetons de l’extérieur sont constitués de pétrole et de ses produits dérivés. Mais aussi, le dollar s’est apprécié par rapport à l’Euro, au franc CFA et à la plupart des monnaies nationales africaines. C’est-à-dire, le dollar a pris de la valeur par rapport au CFA.
Le pétrole est vendu en dollar et nous notre monnaie est le CFA ce qui constitue un handicap pour le pouvoir d’achat même si c’est dans une moindre mesure que le Cédi du Ghana ou le Naira du Nigéria. Non seulement le prix du pétrole a augmenté mais le fait que nous convertissons nos CFA en dollars pour acheter du pétrole, cela fait que la hausse nous a pleinement frappée. Vous avez dû vous en rendre compte au niveau des hausses de prix des transports, de l’alimentation voire des produits locaux.
En dehors de cela, notre économie est résiliente principalement à cause de notre diaspora. Cette diaspora qui compte 5 à 6 millions de personnes envoie chaque année une manne importante dans notre pays. Elle est estimée en moyenne à 600 milliards de FCFA par an uniquement ce qui est comptabilisé à travers les circuits financiers officiels. Je pense que c’est presque le double qui rentre chaque année.
Cette manne de 600 milliards de FCFA est plus importante que l’aide au développement que nous recevons de tous nos partenaires techniques et financiers. Elle est également plus importante que les investissements directs étrangers que nous recevons. Et nous pouvons donc l’évaluer officiellement à près de 2 milliards de FCFA chaque jour.
N.A : Vous parlez de l’inflation. Quelle est la situation de l’inflation aujourd’hui au Mali ?
M.M.M : L’inflation n’est pas maîtrisée. Elle n’est maîtrisée nulle part dans le monde. La stabilité des prix est un objectif de la politique économique et c’est le rôle des banques centrales d’essayer de stabiliser les prix à la consommation parce que l’inflation c’est la hausse généralisée et durable des prix à la consommation.
Quand les prix augmentent, c’est votre pouvoir d’achat qui baisse. Pourquoi la banque centrale essaie de stabiliser les prix ? Parce qu’elle est chargée de l’émission de la monnaie et du contrôle de la masse monétaire. Si le coût de vie augmente votre pouvoir d’achat baisse si votre salaire n’augmente pas.
L’objectif de notre banque centrale commune dans l’espace UEMOA, la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest ((BCEAO) est de maintenir l’inflation entre 1 et 3 % mais nous sommes allés jusqu’à 14% à un moment donné en moyenne alors que rarement nous dépassons les 2 et 3 %.
N.A : Le Mali est à quel niveau d’inflation ?
M.M.M : Le Mali devrait être à environs 6% mais avant la Covid-19 le Mali ne dépassait jamais 2%. C’est donc un phénomène mondial. En plus, comme notre balance commerciale est négative – ce qui veut dire que nous achetons plus que nous ne vendons à l’extérieur- ce qui fait que l’inflation va continuer à augmenter parce que nous ne produisons pas assez au niveau de l’économie nationale pour ensuite exporter des produits transformés.
N.A : La CEDEAO a levé en juillet 2022 ses sanctions économiques et financières le Mali. Quels sont selon vous les impacts réels de cet embargo sur l’économie malienne ?
M.M.M : Ce sera difficile à évaluer mais nous allons ressentir encore pendant de nombreuses années les effets néfastes de ces sanctions inappropriées. C’est pour cela que je pense que ce sont des sanctions iniques, injustes et désastreuses. Malgré qu’il y a eu des exonérations des produits pharmaceutiques, des hydrocarbures et certains produits alimentaires, vous savez l’économie peut être arrêtée à tout moment mais c’est compliqué de la faire redémarrer… Il y a des chiffres qui ont été avancés. Moi, je ne m’aventurerais pas sur ces chiffres mais je pense que ce sont plusieurs points du PIB qui ont été perdus.
N.A : Quelles sont les causes des coupures d’électricité et quelles peuvent être les solutions à envisager ?
M.M.M : Le problème de l’électricité est un problème structurel et non conjoncturel. Mais il va de mal en pis parce que avant il y avait les délestages uniquement pendant les périodes de pointe. Nous sommes dans ce qu’on appelle la loi du marché donc de l’offre et de la demande. L’offre d’électricité au Mali est insuffisante par rapport à la demande.
La demande augmente d’environ 15% chaque année mais l’offre ne suit pas parce que nous avons des installations vétustes, des équipements obsolètes et la mauvaise gouvernance. Il faut produire l’électricité, la transporter, la distribuer puis la commercialiser. C’est essentiellement cela la gestion de l’électricité. Mais nous avons des difficultés dans les postes de production. Ce qu’on appelle le mixte énergétique était essentiellement composé en 2002 de 73% de l’énergie que nous consommions au Mali était de source l’hydro-électrique ( provenant des barrages) et 27% seulement du thermique. Mais aujourd’hui nous sommes à prés de 55% du thermique et près de 30% d’hydraulique. Imaginez que nous ne sommes qu’à 3 à 5% du solaire ou d’énergie renouvelables.
Avec la progression fulgurante du thermique, la consommation du carburant augmente. C’est ce que je vous ai expliqué. L’augmentation du dollar et du prix du pétrole font que le prix du carburant augmente. Actuellement près de 79 à 80% des achats d’EDM-Sa concernent uniquement du carburant et les achats d’énergie. N’oubliez pas que nous avons plus de 20% de l’électricité que nous consommons qui provient d’autres pays ou de producteurs indépendants parce qu’il y a des compagnies privées qui vendent de l’électricité à l’Energie du Mali.
L’offre étant de loin inférieure à la demande et avec les coût de la production qui ont augmenté, tenez vous bien les coûts de production sont en moyenne de 150 FCFA le kilowattheure mais EDM-SA vend l’électricité à 100 FCFA le kilowattheure à la demande de l’Etat. Le plein prix n’est pas appliqué. Ce manque à gagner est supposé être compensé par des subventions qui sont insuffisantes et n’arrivent pas à temps. Ce qui fait que la trésorerie d’EDM est vraiment déficitaire et comme ses comptes financiers ne sont pas certifiés, EDM ne peut pas emprunter sur les marchés de capitaux ou auprès des banques à des taux raisonnables des ressources longues.
N.A : Nous sommes habitués à des coupures d’électricité pendant la période de forte chaleur mais cette année nous les avons connues pendant la fraicheur. Est-ce que ce n’est pas un problème d’argent qui s’impose à l’Etat ?
M.M.M : Je pense que c’est un problème de gouvernance. Je vous ai expliqué pour le mixte énergétique. Avec ce problème de gouvernance, les barrages n’ont pas été entretenus parce que quand vous avez des infrastructures il faut les entretenir, les réparer. Mais ici nous sommes dans la politique de l’urgence. Tant qu’une machine n’est pas arrêtée complètement, on ne fait ni l’entretien ni la réparation.
Si nous mettions beaucoup de moyens uniquement pour faire la réparation et l’entretien sur les lignes de transport et les postes de transformation, cela demande des ressources importantes immédiatement et dans la durée. Malheureusement ni l’Etat ni EDM ne disposent de cette trésorerie parce que pour conserver en bon état les infrastructures il faut mobiliser les ressources, de l’argent frais sur la durée. Mais malheureusement l’Etat ne le fait pas et l’EDM non plus.
Effectivement ce sont de problèmes de ressources financières mais aussi des problèmes de gouvernance. C’est-à-dire comment nous gérons les outils de production parce qu’il s’agit non seulement des installations mais la gestion des ressources humaines, l’instabilité institutionnelle. La demande est en train de croitre à un rythme époustouflant et l’offre ne suit pas, c’est peut-être cela qui nous rattrape.
N.A: Nous remarquons chaque année une hausse des budgets alloués aux institutions de la République. Que pensez-vous de l’augmentation chronique des budgets des institutions au Mali ?
M.M.M: Il ne faut pas voir de cette façon. Si vous prenez la présidence dans laquelle j’ai eu le privilège de travailler, ce n’est pas à travers l’organigramme de la présidence que vous allez voir les actions de la présidence ni la Primature parce qu’il y a beaucoup de services au sein de ces institutions.
Du temps où j’étais à la Présidence, la Sécurité d’Etat y était. Je ne sais pas si elle y est toujours.
N.A : Les deux budgets ne sont plus liés
M.M.M : Les budgets sont différents ? Même là je pense qu’il y a beaucoup de services et d’activités qui peuvent être entrepris par la Primature parce que les cadres organiques de la Primature et la Présidence sont différents de ceux des autres institutions. Mais nous avons un budget qui dépasse 3.000 milliards FCFA pour la première fois mais nous avons un déficit budgétaire de près de 700 milliards FCFA. Cela veut dire que les dépenses budgétaires sont de loin supérieures aux recettes budgétaires. Cette différence doit être empruntée. Ce qui va faire augmenter la dette publique encore.
Mon principal point d’objection est le constat que ces quatre dernières années c’est le budget de fonctionnement de l’Etat qui continue à augmenter au détriment du budget d’investissement. Alors même que c’est le budget d’investissement qui permet à l’économie de croitre et de générer des revenus supplémentaires. Le budget de fonctionnement ne fait pas croitre l’économie, il faut le revoir à la baisse parce qu’il y a beaucoup de dépenses superflues. Je ne vais pas les énumérer mais c’est aux autorités de prendre les mesures nécessaires et qui me paraissent évidentes.
N.A : Le déficit budgétaire. Où est-ce que le Mali pourra avoir des fonds dans un contexte où les certains partenaires ont coupé ou suspendu les aides ?
M.M.M : C’est une très bonne question. J’ai beaucoup travaillé sur cette question. Il fut un temps où 70% des investissements publics étaient financés par l’assistance extérieure qui a fondu comme neige au soleil parce que de nombreux partenaires techniques et financiers se sont retirés du Mali ou ont interrompu l’assistance qu’ils fournissaient au Mali.
Avant la crise multidimensionnelle que notre pays connaît l’assistance extérieure finançait environ 20 à 30% du budget d’Etat. Il s’agit surtout maintenant de surveiller une hausse importante du service de la dette pour éviter les coupures budgétaires aux niveaux des services sociaux de base et du développement socioéconomique. Il faudra surtout développer des sources alternatives de financement de nos économies en développant les marchés financiers locaux et l’épargne locale.

paru en début du février 2024
N.A : Sur le plan régional, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont décidé de créer l’Alliance des États du Sahel (AES). Selon vous, quel est le poids économique de cette alliance ?
M.M.M : Le poids de ces trois pays est non négligeable. Il ne s’agit pas de l’économie seulement mais sur le plan démographique et de la superficie. Ces trois pays font 2 772 000 km². C’est 70% de la surface des huit pays de l’UEMOA. Ils ont une population combinée de 70 millions de personnes, soit 60% des populations des huit Etats de l’UEMOA. Même si leur PIB combiné équivaut à celui de la Côte d’Ivoire, évidement le potentiel est énorme parce que ce sont des pays miniers et agrosylvopastoraux.
Mais encore la transformation structurelle que ces pays envisagent va changer la donne et c’est de cela qu’il s’agit. Comment renforcer la production nationale, la compétitivité de nos économies ? Comment faire baisser le coût de facteurs de productions (le capital physique, financier, les coûts de l’énergie, l’accès à la terre, l’accès à l’eau, la sécurité alimentaire, la formation, les services sociaux de base) ?
L’avantage de cette Alliance des Etats du Sahel, c’est que les défis sont communs. Ils sont transfrontaliers mais ils sont communs à ces trois pays. En regroupant et mutualisant leurs efforts, ces trois pays décuplent leurs forces et cela leur permet de faire face aux défis auxquels ils sont confrontés.
N.A : Est-ce que l’annonce de la création d’une banque d’investissement et d’une union monétaire équivaut à la fin du CFA dans ces pays ?
M.M.M : Non, il faut faire extrêmement attention. Si vous lisez le préambule de la Charte de l’Alliance, il fait référence au respect de la Charte des Nations Unies, à l’Acte constitutif de l’UA, au traité de la CEDEAO. Ce qui veut dire que cette entité compte coopérer avec la communauté internationale mais c’est aux trois pays de gérer les défis qui leur sont communs.
Peut-être que d’autres pays n’ont pas les mêmes préoccupations que ces Etats. Par exemple, le fonds de stabilisation dont vous avez parlé, ces trois pays sont des grands producteurs céréaliers. Comment faire face aux chocs climatiques, aux ressources hydriques, aux intrants, nourrir et abreuver le cheptel ? Mais aussi des problèmes de connectivité. Ce sont des pays enclavés, vastes, semi-arides. Comment améliorer la connectivité, le transport ferroviaire, aérien, routier et fluvial pour fluidifier davantage les échanges et renforcer la coopération sécuritaire.
Je pense que c’est une bonne idée de se regrouper pour les pays africains et de renforcer la coopération sous-régionale sur leurs priorités. Sans oublier qu’il existe déjà une organisation sous-régionale (l’Autorité de Développement intégré du Liptako-Gourma) qui est une organisation socio-économique regroupant les 3 pays de l’AES mais qui a commencé depuis 2017 à prendre en compte les aspects sécuritaires dans la zone des frontières des trois pays d’une superficie de 400 000 km2.
Le fonds de stabilisation de l’AES va servir à contrer les chocs exogènes et l’insécurité alimentaire. La banque d’investissement va permettre de renforcer l’outil de production et les infrastructures de base. Comment renforcer l’industrialisation par exemple et les infrastructures pour améliorer la connectivité, la production et la compétitivité.
N.A : A votre entendement, la création de l’Union économique et d’une banque ne veulent pas dire que le FCFA va disparaitre ?
M.M.M : Le Franc CFA peut disparaître à tout moment parce qu’il y a une clause dans l’accord de coopération monétaire qui fait que les États peuvent se retirer à tout moment de l’UEMOA. Ils n’ont pas activé cette clause pour le moment mais peuvent le faire. Mais ce que moi j’ai compris c’est que l’objectif de l’AES est d’aller vers un regroupement d’intégration économique et monétaire parce que le stade ultime de l’intégration économique et monétaire c’est d’avoir une monnaie commune ou une monnaie unique.
Ces trois pays ont déjà cette monnaie commune le FCFA. Ils peuvent décider de créer une autre monnaie commune mais cela engendre d’autres difficultés parce qu’il faudra mettre en place une banque centrale, fixer le taux change et le régime de change. La création d’une monnaie n’est pas une panacée et ne pourra pas à elle seule assurer la productivité et la compétitivité de nos économies.
N.A : Un tel scénario ne signifierait -il pas le retrait de ces pays de la CEDEAO ?
M.M.M : Malgré que le préambule de la Charte de l’AES évoque le respect du Traité révisé de la CEDEAO, les trois pays de l’AES ont notifié leur retrait de la CEDEAO cet acte n’a pas été entériné par la Conférence des Chefs d’État de Gouvernement de la CEDEAO qui s’est réunie le samedi 24 février 2024 en Abuja ( Nigéria).
N.A : Comment voyez -vous les perspectives de cette alliance ?
M.M.M : Les perspectives sont bonnes pour cette Alliance. Je pense que c’est une très bonne chose que les pays se préoccupent de leur devenir parce que j’ai l’impression que nous sommes laissés pour compte dans les regroupements dans lesquels nous sommes. L’intégration économique et monétaire, c’est la solidarité. Ces pays traversent des difficultés mais ont fait face à des sanctions qu’on ne peut pas justifier. J’aurai compris des sanctions ciblées mais on ne peut cibler les populations pour ce dont elles ne sont pas responsables.
Ce sont des organismes d’intégration. Ils doivent renforcer la circulation des personnes, des biens et des facteurs de production. Pas de les entraver. Il y a des clauses que nos pays ont signées notamment le protocole additionnel par rapport à la gouvernance et la démocratie. Evidemment des sanctions doivent être prises. Mais est-ce qu’elles doivent être prises contre les peuples ? Doivent -elles entraver l’intégration économique au lieu de la renforcer ? Ce sont des questions que je me pose.
Je pense qu’il va falloir revoir ces clauses de sanctions, les paradigmes de l’intégration économique pour rendre l’accès aux ressources et la gestion de ces organismes plus transparente, égalitaire et solidaire. Quand les pays traversent des difficultés, les autres doivent être là pour les épauler. Cela n’a pas été le cas pour le Mali et ce n’est pas le cas des trois pays qui sont aujourd’hui regroupés au sein de l’AES.
Mot de la fin
Notre mot de la fin, c’est le mot de l’espoir. C’est de dire que l’Afrique est un continent en devenir, que les Africains doivent compter sur eux-mêmes, que nous constituons désormais 1,5 milliards d’habitants autant que la Chine et l’Inde, et l’Afrique doit prendre son destin en main sans délai pour assurer sa propre sécurité et sa future prospérité.
Je vais terminer par ce mot de Kwamé Nkrumah : « c’est uni que nous sommes forts, divisés nous périrons ».