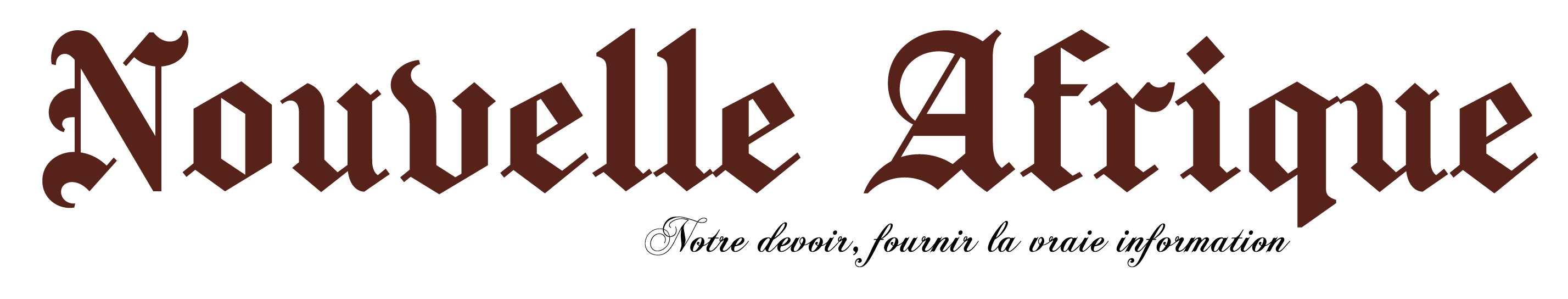Bien que recommandé par les différents fora depuis 2017, notamment la Conférence d’Entente Nationale, le Dialogue National Inclusif (DNI), les Assises Nationales de la Refondation (ANR) et le Dialogue Inter-Maliens (DIM), le dialogue avec les groupes terroristes continue de diviser les Maliens.
Au Mali, il n’y a toujours pas d’unanimité autour du dialogue avec les groupes terroristes, particulièrement ceux dirigés par Iyad Ag Ghaly et Amadou Kouffa. Nombreux sont les Maliens qui estiment que le dialogue avec ces groupes est la voie la plus sûre pour aboutir à une paix durable. D’autres pensent le contraire, affirmant que les forces terroristes ne sont pas dignes de confiance.
Ce que demandent les Fora depuis 2017
En 2017, alors que le Nord et le Centre du Mali étaient fragilisés par les attaques terroristes visant non seulement les positions des forces armées et de sécurité du Mali, mais aussi les populations civiles, la Conférence d’Entente Nationale a recommandé le dialogue avec les terroristes maliens. Cette recommandation avait été soutenue, à l’époque, par des organisations politiques et de la société civile. Cependant, aucune action concrète n’avait suivi cette recommandation.
Deux ans plus tard, le Dialogue National Inclusif, tenu en 2019, a, lui aussi, recommandé de dialoguer avec les terroristes maliens. La même demande a été formulée sous la transition en cours, notamment lors des Assises Nationales de la Refondation (ANR) et du Dialogue Inter-Maliens. Ces recommandations de dialogue avec les groupes terroristes (à l’exception de celles formulées par le Dialogue Inter-Maliens) ont été faites en présence des troupes étrangères au Mali. À l’époque, la France, partenaire stratégique, s’était catégoriquement opposée à tout dialogue avec les terroristes.
Le dialogue, une voie sûre vers la paix
Bien avant la Conférence d’Entente Nationale, Tiébilé Dramé et son parti avaient soutenu le dialogue avec les terroristes. « Il ne sert à rien de nous cacher derrière notre petit doigt, regardons plutôt la vérité en face. Nous avons aujourd’hui des Coulibaly, des Mamadou, des Tounkara, des Konaté dans les groupes djihadistes : ce sont nos frères maliens. Nous devons parler avec eux », avait indiqué en 2016 Tiébilé Dramé à nos confrères du journal français Le Monde. « Des chefs djihadistes comme Mokhtar Belmokhtar, Abou Zeid ou Abderrazak El Para n’avaient pas vocation à se retrouver au Mali. Ils s’y sont installés à l’époque par la faute des dirigeants de notre pays. En revanche, Iyad Ag Ghali, Amadou Kouffa et les autres sont nos frères. C’est avec eux que nous devons discuter dans le cadre des assises nationales qui aborderont tous les problèmes du Mali », avait soutenu le président du parti du Bélier blanc dans le même texte. Ce parti avait maintenu cette position lors des différents fora auxquels il a participé depuis 2017.
Pour Moussa Diarra, sociologue que nous avons contacté, le dialogue est la meilleure arme pour aboutir à une paix durable. « Ce sont les Maliens qui ont participé aux différentes rencontres, de la Conférence d’Entente nationale au Dialogue Inter-Maliens. Ce sont eux qui ont demandé le dialogue. Et je pense que c’est une bonne option », a-t-il déclaré avant d’ajouter qu’il « faut dialoguer avec les terroristes maliens qui veulent revenir à la raison ». Pour ce sociologue, la solution militaire seule ne suffit pas dans le contexte du Mali. « Dans certaines localités du pays, les terroristes sont ancrés dans la population. Il faut donc non seulement inviter les terroristes à revenir à la raison, mais aussi sensibiliser les populations sur les dangers d’appartenir à un groupe terroriste », soutient M. Diarra.
Dans une interview publiée sur le site de Timbuktu Institute en 2019, le chercheur malien Aly Tounkara, évoluant dans le domaine de la sécurité, a soutenu, à son tour, la tenue du dialogue. « On a vu en Irak, en Afghanistan, en Syrie, ces mêmes puissances étrangères occidentales avaient catégoriquement refusé de déclencher le dialogue avec Al-Qaida, les Talibans mais elles ont fini par comprendre que les réponses militaires, à elles seules, ne peuvent contenir l’action violente des groupes djihadistes. Des pourparlers ont été engagés entre les États-Unis et les Talibans, entre la France, l’Angleterre et certains éléments de l’État islamique. La force militaire est nécessaire, mais ne suffit pas. J’ai dit et écrit qu’il est urgent, voire impérieux d’engager le dialogue avec ces groupes radicaux au Mali. On me dira qu’il y a mille et Un groupes à la fois. Certes, il y a toute une kyrielle de groupes, mais les « gros poissons » sont connus. Il y a une cartographie des acteurs qui opèrent sur le terrain. On sait qu’au Centre du Mali, la katiba de Malam Dicko et celle d’Amadou Kouffa sont les plus actives. Quand on s’intéresse aux régions du Nord, la katiba Ançar Dine d’Iyad Aghaly opère suffisamment dans la zone. On connaît les aires géographiques d’intervention de ces différents groupes violents », avait-il laissé entendre.
En 2024, dans une tribune, le général Yamoussa Camara, Conseiller Spécial du président de la transition, a proposé le dialogue aux actions militaires. Pour lui, les armes seules ne pourront pas résoudre la crise que traverse le Mali. Moussa Mara, ancien Premier ministre, est, lui aussi, favorable à un dialogue avec les groupes armés maliens. Cette volonté, il l’a exprimée publiquement lors d’une conférence de presse.
Pas de négociation avec les terroristes
S’il y a ceux qui se battent pour qu’il y ait un dialogue pour faire revenir les terroristes à la raison , certains Maliens, dont des hauts cadres, disent « niet » à cette proposition. Au premier rang de ces contestataires se trouve l’ancien Premier ministre de la Transition rectifiée, Dr Choguel Kokalla Maïga. « Certains viennent nous dire : “Ah, vous savez, la guerre seulement ne règle pas le problème d’un pays, il faut négocier.” On trouve même des spécialistes qui citent dans l’histoire des exemples. Mais est-ce qu’on n’a jamais dit ça ? Personne n’a jamais dit ça ! Le Mali a négocié pendant 30 ans ; est-ce que cela a emp ché le terrorisme de s’étendre ? Est-ce que cela l’a empêché d’arriver au Burkina ou au Niger où il n’était pas ? », avait déclaré Dr Choguel Kokalla Maïga. À son entendement, ces propositions constituent des discours spécieux, de nature à cultiver le défaitisme, sinon le pessimisme, pour amener le gouvernement à « négocier ». Sans détour, il a indiqué « qu’il n’y a pas de négociation avec les terroristes ».
Pour lui, le terroriste doit juste être combattu comme tel. « Les terroristes, il faut les combattre. Le jour où ils se sentiront suffisamment affaiblis, ils viendront négocier », avait soutenu Choguel Kokalla Maïga. Cette posture est soutenue par Abdala Togo, un proche de Dana Ambassagou contacté par nos soins. « Pour moi, un État ne doit pas dialoguer avec les terroristes. L’État doit avoir des interlocuteurs crédibles. Or, les terroristes ne le sont pas. Il faut juste les combattre », a précisé ce jeune quadragénaire, qui se bat même contre les accords locaux au centre du Mali.
Un jeune, cette fois-ci leader politique, Cheick Oumar Diallo, s’oppose lui aussi au dialogue avec les terroristes. Il trouve que les groupes terroristes ne sont pas des interlocuteurs fiables.
Il faut spécifier qu’au même moment, les populations sont contraintes de signer des accords locaux avec les terroristes pour pouvoir vivre en paix dans beaucoup de localités au centre du Mali. Même s’ils sont considérés comme des diktats des terroristes contre les populations, ces accords permettent à certaines populations de réaliser des travaux champêtres. Pour combien de temps ? On ne saurait le dire.
L’État du Mali va-t-il un jour engager du dialogue avec les terroristes maliens ? Le futur nous le dira.
NB: cet article a été publié dans le magazine Nouvelle Afrique du mois de Mars 2025
B.G/NouvelleAfrique